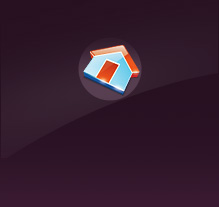Diaphragme et paroi abdominale postérieure
Le diaphragme est une cloison musculo-tendineuse, en forme de double dôme, qui sépare les cavités thoracique et abdominale. Sa face supérieure convexe est orientée vers la cavité thoracique et sa face inférieure concave, vers la cavité abdominale. Principal muscle de l'inspiration (réellement la respiration dans son ensemble, l'expiration étant largement passive), il s'abaisse pendant l'inspiration ; ce mouvement ne concerne toutefois que sa partie centrale du fait que sa partie périphérique, est l'origine fixe du muscle, qui s'insère sur le bord inférieur de la cage thoracique et sur les vertèbres lombaires supérieures. Le péricarde, contenant le cœur, repose sur la partie centrale du diaphragme en la déprimant légèrement. La convexité du diaphragme s'accuse de chaque côté pour former les coupoles (ou dômes) diaphragmatiques droite et gauche ; normalement, la coupole droite est plus élevée que la gauche. Pendant l'expiration, la coupole droite s'élève jusqu'à la 5e côte et la coupole gauche jusqu'au 5e espace intercostal ; cette différence est due à la présence du foie. Le niveau des coupoles diaphragmatiques varie selon :
- La phase de la respiration (inspiration ou expiration).
- La position (par ex., debout ou couchée).
- Le volume et le degré de distension des viscères abdominaux.
La partie musculaire (charnue) du diaphragme se trouve en périphérie ; ses fibres convergent radiairement vers la partie centrale, aponévrotique (tendineuse), trifoliée, le centre tendineux (centre phrénique). Le centre tendineux ne possède aucune insertion squelettique et est incomplètement subdivisé en trois folioles qui le font ressembler à une grande feuille de trèfle. Bien que situé au centre du diaphragme, le centre tendineux est plus proche de la paroi antérieure que de la paroi postérieure du thorax. Le foramen de la veine cave, dans lequel la portion terminale de la VCI s'engage avant de déboucher dans l'oreillette droite, perfore le centre tendineux. La portion musculaire qui entoure ce dernier forme un feuillet continu ; toutefois, pour les besoins de la description, elle est subdivisée en trois parties sur la base de ses insertions périphériques :
- Une partie sternale, représentée par deux languettes musculaires qui se fixent sur la face postérieure du processus xiphoïde ; cette partie n'est pas toujours présente.
- Une partie costale, formée par de larges faisceaux musculaires qui se fixent de chaque côté à la face profonde des six derniers cartilages costaux et des côtes adjacentes ; ce sont les parties costales qui constituent les coupoles droite et gauche.
- Une partie lombaire, qui prend ses origines sur deux arcades aponévrotiques, les ligaments arqués médial (arcade du psoas) et latéral (arcade du carré des lombes ou ligament cintré), ainsi que sur les trois vertèbres lombaires supérieures ; la partie lombaire forme les piliers musculaires droit et gauche du diaphragme qui montent à la rencontre du centre tendineux.
Les piliers du diaphragme sont des faisceaux musculo tendineux qui naissent de la face antérieure des corps des trois premières vertèbres lombaires, du ligament longitudinal antérieur et des disques intervertébraux. Le pilier droit, plus large et plus long que le pilier gauche, prend ses origines sur les trois ou quatre premières vertèbres lombaires. Le pilier gauche se fixe sur les deux ou trois premières de ces vertèbres. L'hiatus œsophagien est situé à gauche de la ligne médiane et il peut donc paraître surprenant de constater qu'il est délimité par des fibres du pilier droit. En suivant toutefois vers le bas le trajet des fibres musculaires qui bordent les deux côtés de ce hiatus, on constate qu'elles passent à droite de l'hiatus aortique. Les piliers droit et gauche et le ligament arqué médian, fibreux, qui les unit lorsqu'ils passent au-devant de l'aorte, forment Yhiatus aortique. Plus latéralement, le diaphragme s'insère également sur le ligament arqué médial (arcade du psoas) et sur le ligament arqué latéral (arcade du carré des lombes, ligament cintré) ; ces ligaments sont, en fait, des épaississements du fascia qui tapisse respectivement les muscles grand psoas (tendu entre les corps des vertèbres lombaires et le sommet du processus transverse de L1) et carré des lombes (compris entre le processus transverse de L1 et le sommet de la 12e côte). La face supérieure du centre tendineux du diaphragme (le mince et puissant tendon aponévrotique de toutes les fibres musculaires du muscle) est fusionné avec la face inférieure du péricarde fibreux, la partie externe résistante du sac péricardique fibro-séreux qui entoure le cœur.
Paroi abdominale postérieure
La paroi abdominale postérieure comprend principalement :
- Les cinq vertèbres lombaires et les disques IV associés.
- Les muscles de la paroi abdominale postérieure : grands psoas, carrés des lombes, iliaques, transverses de l'abdomen et muscles obliques (latéralement).
- Le diaphragme, qui contribue à former la partie supérieure de la paroi postérieure.
- Les fascias, y compris le fascia thoraco-lombaire.
- Les plexus lombaires constitués par les branches antérieures des nerfs spinaux lombaires.
- De la graisse, des vaisseaux (par ex., l'aorte et la VCI) et des nœuds lymphatiques.
Si l'on observe l'anatomie de la paroi abdominale postérieure sur des schémas en deux dimensions, il est facile de supposer qu'elle plate. En la considérant sur un cadavre disséqué ou sur une coupe transversale, il est apparent que la colonne vertébrale lombaire constitue une proéminence centrale dans la paroi abdominale postérieure, donnant naissance à des « gouttières » paravertébrales de chaque côté. La partie la plus profonde de ces gouttières est occupée par les reins et la graisse qui les entoure. L'aorte abdominale se trouve en avant de la colonne vertébrale saillante. Il est habituellement étonnant de réaliser combien l'aorte abdominale inférieure est proche de la paroi abdominale antérieure, chez les sujets maigres. Bien entendu, de nombreuses structures se trouvent devant l'aorte (AMS, parties du duodénum, pancréas et veine rénale gauche, etc.) et ainsi ces « structures abdominales postérieures » peuvent s'approcher de la paroi abdominale antérieure davantage qu'attendu et spécialement chez les sujets maigres, surtout en position couchée.